La largeur de vue que permettait le thème général « (In)visibilité » a permis à l’histoire militaire de se frayer une place. Un panel commun de la MILAK et de l’ASHSM, bien organisé et dirigé par notre membre Dr. Tamaro Cubito, a réuni une bonne cinquantaine de personnes, preuve que le domaine suscite encore de l’intérêt.
Mr. Andri Schläpfer, doctorant, a présenté quelques aspects de la guerre du Sonderbund qui ont été occultés « par la fumée de la poudre des fusils et des canons » (au propre comme au figuré) et par la rapidité de la décision emportée par l’Armée de la Diète sur celle des Cantons du Sonderbund. Seules la victoire militaire et la modification structurelle du Pays qui en découla restèrent généralement dans la mémoire collective et dans l’histoire officielle.
Mais on oublie souvent de mentionner les problèmes d’organisation des troupes, des blessés et des invalides à soigner, de la motivation des soldats qui n’arrivaient pas à s’identifier aux objectifs religieux ou politiques des parties en conflits (d’où la difficulté à déclarer « ennemi » ceux qui étaient en face), de maintien de la discipline de la troupe, mais aussi de la violence à laquelle les troupes de milice n’étaient pas accoutumées.
Ces aspects ont été peu documentés ni analysés, tout comme il n’y a que peu de lieux de mémoire. Mais ils sont restés longtemps marqués dans les mémoires individuelles ou familiales des personnes concernées – des deux bords – et n’ont été apaisé que longtemps plus tard. Il y aurait certainement matière à compléter l’approche de cette phase marquante de notre histoire.
Dr. Mario Podzorski a apporté une vision peu traitée de l’histoire de l’armée suisse durant la Première guerre mondiale : l’évolution de la motivation de certains officiers au fil des 4 ans de service actif. Il s’est plongé pour cela dans la lecture de nombreux journaux personnels ou de correspondance avec leurs familles.
Alors qu’on pouvait y discerner initialement, en 1914, une volonté marquée de servir et de défendre le Pays, elle fut rapidement suivie de déception car il ne se passait rien. Et vint pendant de longs mois la seule protection de la frontière, monotone et répétitive au fil des relèves, et qui fit perdre la motivation sur la raison de l’appel et du maintien sous les drapeaux. Puis l’image de l’adversaire se modifia : d’un potentiel ennemi militaire étranger, on se méfia d’un ennemi intérieur qui déstabiliserait le Pays et la société. Ce qui amena à un nouveau vent de motivation lorsqu’il s’agit d’effectuer un service d’ordre en 1918.
Ces évolutions sont intéressantes, mais ont été tues par leurs auteurs, car personnelles voire intimes. Mais on peut incontestablement s’imaginer qu’elles ont été vécues, de manière similaire, par la plupart des hommes mobilisés. Cela démontre l’importance de la communication dans les activités de conduite, ce qui a été manifestement négligé durant cette période de notre histoire.
Prof. Dr. Stig Förster a fait quant à lui des considérations plus générales sur la problématique de l’(in)visibilité de l’histoire militaire. Pour lui, celle-ci n’est pas invisible, bien au contraire ; les médias et la population en parlent régulièrement. Ce qui devenu invisible, ce sont l’enseignement et la recherche dans le domaine ; preuve en est la disparition des chaires spécifiques dans les universités. Cela serait cependant nécessaire, afin de dépoussiérer les idées stéréotypées, de mettre en lumière des faits négligés ou oubliés, de montrer les interactions entre les développements politiques et les actions militaires vues comme conséquences ou comme déclencheurs.
Cette invisibilité de la recherche n’est pas un phénomène purement suisse, mais sensible dans de nombreuses parties du monde et spécialement en Europe occidentale. De ce fait, on oublie le comment et le pourquoi des guerres, et on repart dans des mécanismes qui peuvent être destructeurs !
Le besoin d’histoire militaire est bien là… mais personne ne veut s’atteler à (re)dynamiser la recherche et la diffusion dans le domaine, à l’échelon académique voire institutionnel. Pourquoi ? Poser la question, c’est peut-être déjà commencer à relancer le sujet…
La discussion qui s’ensuivit avec l’auditoire montra que l’on a eu trop tendance, par le passé, à vouloir donner à l’histoire militaire des frontières claires avec les autres domaines historiques, et que les « zones grises » ont été progressivement phagocytées par d’autres, au détriment de la thématique qui nous intéresse. L’histoire militaire fait partie de l’histoire générale, avec toutes les conséquences des conflits sur la société, son économie, sa structure politique, son évolution sociale et culturelle. Il ne faut pas se gêner de l’explorer et de le montrer. Mais il ne faut pas mélanger la sociologie des militaires avec l’étude de la force en mains de la politique et de l’Etat ; ce deuxième aspect a eu tendance à être négligé au profit du premier. En fait, il faut tenir compte de tous les paramètres, et surtout ne pas négliger le facteur humain, composant indispensable des forces armées mais aussi source originelle de tous les conflits…
Ce panel a été une excellente occasion de montrer, de manière non dogmatique, les possibilités qu’il y a à étudier et à diffuser l’histoire militaire ; son contenu et l’intérêt qu’il a suscité confortent l’ASHSM dans la poursuite de ses objectifs.

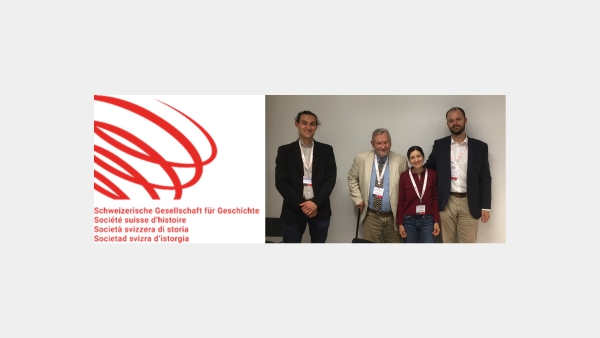

 Français
Français  Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Schweiz)